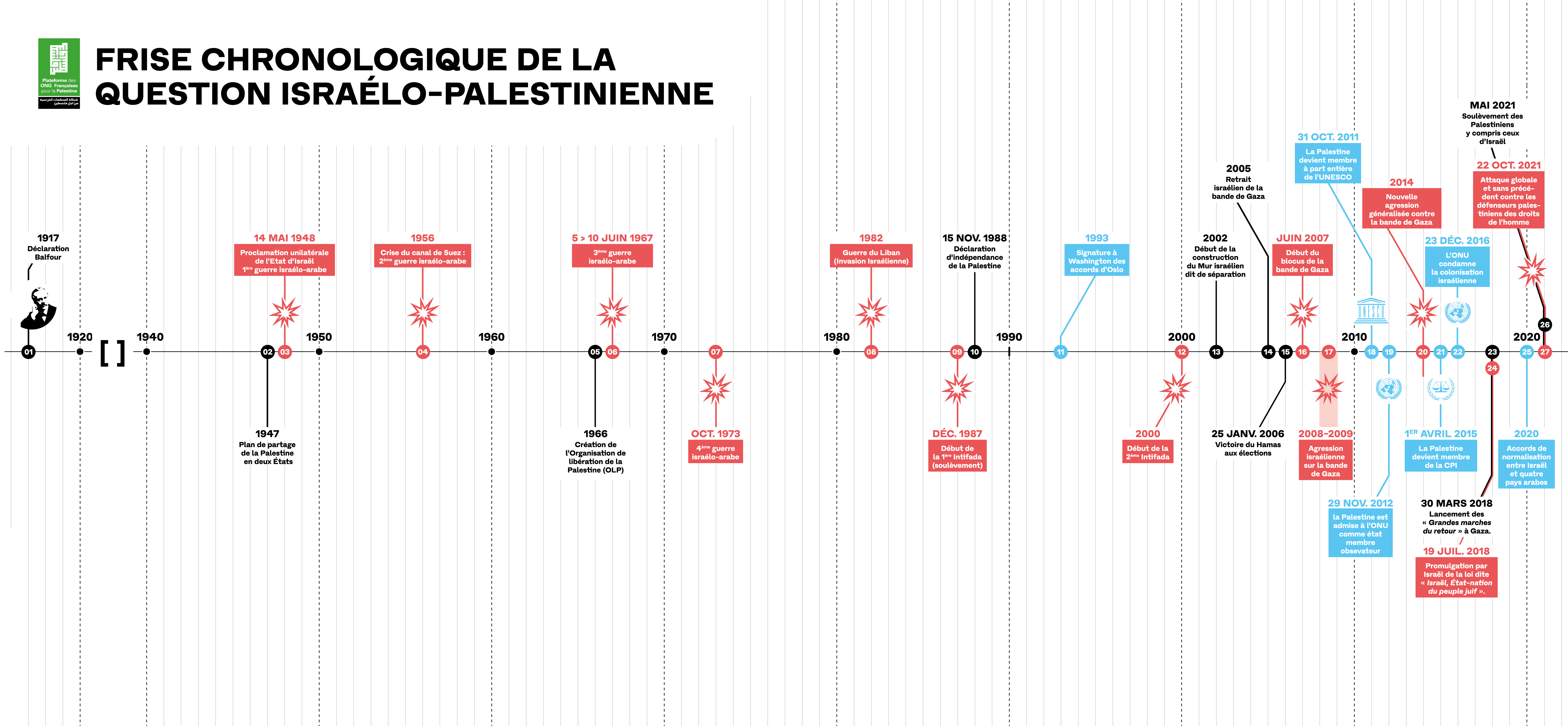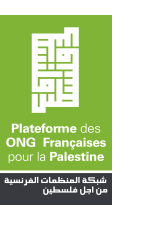

Palestine : la frise chronologique
Télécharger la frise aux formats JPG ou PNG.
01 : 1917 - Déclaration Balfour
Lord Balfour, au nom du gouvernement britannique, promet au mouvement sioniste (créé en 1897)
« l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine... ». Les droits politiques (à partir de 1922) des non-juifs, 90% de la population, ne sont pas évoqués ! Le Mandat britannique sur la Palestine intègre la déclaration Balfour et verra un afflux, organisé par le mouvement sioniste, de juifs européens fuyant les persécutions et le nazisme. Révoltes et grèves (en 1936) des Palestiniens contre l’occupation britannique et la colonisation qui les dépossèdent.
02 : 1947 - Plan de partage de la Palestine en deux États
Le 29 novembre 1947, dans le contexte post génocide des juifs en Europe, l’Assemblée générale de L’ONU recommande (Résolution 181) un plan de partage de la Palestine avec :
- un « État juif » sur 56% du territoire, alors que la population juive (34%) n’en possède que 7%, où résident 955 000 personnes, dont 45% de non-juifs.
- un « État arabe » où résident 755 000 personnes dont 10 000 juifs.
- un statut international pour le secteur de Jérusalem.
Les dirigeants du mouvement sioniste acceptent ce plan comme première étape. Les Arabes palestiniens et les États arabes refusent ce plan absurde (7 morceaux imbriqués !) et cette dépossession injuste.
A partir de fin 1947 les Palestiniens fuient les violences (terreur, massacres, destructions...), c’est le début de l’expulsion, de la Nakba (catastrophe). Le Plan Dalet organise le nettoyage ethnique de dizaines de villages comme Deir Yassine et villes : Jaffa, Haïfa, Safed, Tibériade, Jérusalem-Ouest...
03 : 14 mai 1948 - Proclamation unilatérale de l’Etat d’Israël 1re guerre israélo-arabe
Le 15 mai l’Égypte, la Jordanie, l’Irak et la Syrie entrent en guerre mais seront vaincus ainsi que la résistance palestinienne. L’armée israélienne continue le nettoyage ethnique.
Un accord d’armistice définissant une ligne de démarcation (la Ligne verte) est signé en 1949 :
- • L’État d’Israël contrôle alors 77% du territoire de la Palestine d’où 80% de la population non-juive a été expulsée. Israël n’a jamais défini ses frontières.
- • La Jordanie annexe la Cisjordanie, l’Égypte administre la bande de Gaza.
- • Depuis fin 1947 plus de 500 villages et quartiers ont été détruits, 800 000 Palestiniens ont été expulsés. Après le 15 mai 1948, 10 000 juifs ont été expulsés de Cisjordanie.
La résolution 194 de l’ONU du 11/12/1948 reconnait le droit au retour des réfugiés palestiniens.
04 : 1956 - Crise du canal de Suez : 2e guerre israélo-arabe
À la suite de la nationalisation du canal de Suez, la France, le Royaume-Uni et Israël attaquent l’Egypte. Israël occupe la bande de Gaza et le Sinaï puis les restitue sous pression américano-soviétique.
05 : 1966 - création de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP)
L’OLP réunit plusieurs mouvements (Fatah, FPLP...), associations et syndicats.
06 : 5 au 10 Juin 1967 - 3e guerre israélo-arabe
Cette guerre dite des « Six jours » a été voulue et planifiée par Israël qui attaque et occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, et le Golan syrien. Environ 350 000 Palestiniens sont expulsés. La colonisation débute, Israël annexe Jérusalem-Est et déclare Jérusalem comme sa capitale : faits accomplis contraires au Droit international et condamnés par la communauté internationale.
Le 22 novembre 1967, l’ONU adopte la résolution 242 qui demande notamment le retrait des territoires occupés.
07 : Octobre 1973 - 4e guerre israélo-arabe
L’Égypte et la Syrie attaquent Israël dans le but de récupérer les territoires occupés en 1967. Israël sera victorieux mais restituera une partie du Golan à la Syrie et le Sinaï à [’Égypte (1979).
08 : 1982 - Guerre du Liban (Invasion Israélienne)
Massacres de Sabra-Chatila (Camp de réfugiés palestiniens à Beyrouth)
09 : Décembre 1987 - Début de la Première Intifada (soulèvement)
Mouvement de résistance populaire et non armé. Jeunes, enfants, femmes, commerçants, intellec-tuels, employés, paysans... protestent contre l’occupation et mettent en place des structures agri-coles, sanitaires, éducatives... L’armée d’occupation réprime : milliers de blessés et de prisonniers. Tous les partis sont actifs dont le Hamas qui émerge à ce moment.
10 : 15 novembre 1988 - Déclaration d’indépendance de la Palestine
Par le Conseil National Palestinien (Parlement en exil à Alger) qui reconnait les résolutions des Nations unies (181, 242 et 338) et donc l’État d’Israël. Yasser Arafat, président de l’OLP, renonce totalement au terrorisme.
11 : 1993 - Signature, à Washington, des accords d’Oslo
Dans le contexte post guerre du Golfe, post guerre froide, épuisement de Intifada... Yasser Arafat signe, au nom de l’OLP, avec Yitzhak Rabin une déclaration de principe israélo-palestinienne négociée à Oslo qui reflète l’asymétrie des forces. Arafat reconnait l’État d’Israël et son « droit » « à vivre en paix et dans la sécurité ». Rabin reconnait « l’OLP comme représentant légitime du peuple palestinien » mais pas l’État de Palestine ni son droit « à vivre en paix et dans la sécurité ». Une solution définitive aux questions essentielles (frontières, colonies juives, réfugiés, Jérusalem...) doit être trouvée dans les cinq ans.
25 février 1994 : massacre de 29 fidèles (et 129 sont blessés) dans la mosquée d’Hébron par un colon juif. Yitzhak Rabin ne sévit pas contre ces colons les plus extrémistes ce qui brise la confiance de beaucoup de Palestiniens dans ledit Processus de Paix. Avril 1994 : début d’attentats suicides par des groupes palestiniens.
Le second accord intérimaire (Oslo 2) du 28 septembre 1995 met en place l’Autorité palestinienne (AP) et les zones A (3% sous contrôle AP), B (27%, contrôle mixte) et C (70% sous contrôle israélien). La colonisation s’accélère, mise en place de barrages et d’enclaves palestiniennes (Gaza, Jéricho...). Le piège d’Oslo se concrétise, la Communauté Internationale laissant faire la puissance occupante avec laquelle l’Union européenne signe même un accord d’association.
Yitzhak Rabin est assassiné le 28 septembre 1995 par un extrémiste juif.
12 : 2000 - Début de la deuxième Intifada
Juillet 2000 : échec du sommet de Camp David, les dirigeants israéliens voulant notamment annexer une partie de la Cisjordanie, la souveraineté sur Jérusalem et enterrer le droit au retour des réfugiés.
28 septembre 2000 : début d’un soulèvement à la suite de la visite d’Ariel Sharon, chef du parti Likoud, sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem. Cette Intifada pour partie armée laisse peu de place à la société civile, contrairement celle de 1987. L’armée israélienne envahit les villes de la Zone A et assiège Arafat à Ramallah.
La répression israélienne est terrible : environ 3500 tués, massacres (à Jénine, Naplouse...), assassinats de dirigeants, milliers de prisonniers, destructions d’habitations et d’infrastructures... Les attentats palestiniens en Israël font environ 1000 morts.
13 : 2002 - Début de la construction du Mur israélien de séparation
En réalité, il sépare des Palestiniens vivant de chaque côté du Mur, les isole de leurs champs, travail, écoles... et annexe 9% de la Cisjordanie avec des ressources importantes d’eau.
Ce mur d’annexion et d’apartheid est condamné le 9 juillet 2004 par la Cour Internationale de Justice.
14 : 2005 - Retrait israélien de la bande de Gaza
Retrait unilatéral, non négocié avec l’Autorité palestinienne, avec évacuation des 9 000 colons. Toutes les issues terrestres et maritimes restent contrôlées par l’armée israélienne.
15 : 25 janvier 2006 - Victoire du Hamas aux élections
Élections législatives reconnues transparentes par les observateurs internationaux. Le Hamas obtient 76 sièges au parlement, le Fatah 46.
16 : Juin 2007 - début du blocus de la bande de Gaza
En juin le Hamas prend le contrôle des services de sécurité dans la bande de Gaza.
Aussitôt Israël impose un blocus quasi total isolant ses habitants, dont 70 % sont des réfugiés, du reste de la Palestine et du monde, et les privant de produits alimentaires, sanitaires, de carburants, d’électricité... Le chômage et la pauvreté explosent.
17 : 2008-2009 - Agression israélienne sur la bande de Gaza
Pendant 23 jours la bande de Gaza subit les bombardements aériens, terrestres et maritimes. 1 400 personnes sont tuées et 5 300 blessées, en grande majorité des civils. 13 israéliens sont tués, surtout des militaires, par les groupes armés palestiniens.
18 : 31 octobre 2011 - La Palestine devient membre à part entière de l’UNESCO
19 : 29 novembre 2012 - L’Assemblée générale de l’ONU accorde à la Palestine le statut d’État non-membre de L’ONU
20 : 2014 - nouvelle agression généralisée contre La bande de Gaza
À la suite notamment de l’accord de réconciliation Fatah-Hamas du 24 avril, attaques aériennes par l’armée israélienne puis terrestres pendant 50 jours à partir du 8 juillet 2014 : 2 251 Palestiniens sont tués (dont 65% de civils), destructions massives... 78 Israéliens sont tués dont 64 soldats par les groupes armés palestiniens. Roquettes palestiniennes sur Israël.
21 : Le 1er avril 2015 : La Palestine devient membre de La Cour pénale internationale
La Palestine devient le 123e membre de la Cour Pénale Internationale de La Haye. Elle peut désormais y agir en qualité d’État et y voter.
22 : Le 23 décembre 2016 : L’ONU condamne La colonisation israélienne
Le Conseil de Sécurité de l’ONU adopte la résolution 2334 condamnant la colonisation israélienne dans le territoire palestinien occupé. Le texte est adopté grâce à l’abstention des États-Unis.
23 : 30 mars 2018 : Lancement des « Grandes marches du retour » à Gaza
Mouvement de protestation pacifique pour la levée du blocus et le droit au retour. Réprimé par les armes israéliennes de manière disproportionnée. Bilan de l’ONU : 214 Palestiniens tués, 16 499 blessés dont 7 000 par balles réelles, 156 seront amputés. 8 Israéliens ont été blessés.
24 : 19 juillet 2018 : Promulgation par Israël de La loi dite « Israël, État-nation du peuple juif »
Cette loi fondamentale ne reconnaît le droit à l’autodétermination qu’au seul « peuple juif », fait de la colonisation une valeur nationale et retire à l’arabe son statut de langue officielle au côté de l’hébreu. Cette loi institutionnalise le régime d’apartheid, qui a fait l’objet de rapport par les ONG B’Tselem, Amnesty International et Human Rights Watch.
Partager / imprimer



Rechercher par thématique
campagne 2017
Campagne en cours
Dernières publications
 31 mai 2024
Européennes : quels engagements des candidats pour la Palestine ?
La question palestinienne en France
UE/Palestine
31 mai 2024
Européennes : quels engagements des candidats pour la Palestine ?
La question palestinienne en France
UE/Palestine
 30 mai 2024
Rafah, blocus étudiants et écocide
Analyses politiques et géopolitiques
Colonisation
Eau
Bande de Gaza
Politique française
Jérusalem
Autorité palestinienne
Positions officielles de la France
Nations unies
Torture et mauvais traitements
Universités
Agriculture
Etat de Palestine
Droit international
Solidarité internationale
Enfance/jeunesse
Histoire/analyse politique
Culture / art
Réfugiés palestiniens
Destructions
Aide internationale
La question palestinienne en France
Occupation/annexion
Diplomatie
Hamas
Société civile
Transferts forcés
Crime de guerre
UE/Palestine
Société française
Liberté d’expression
Armement
Violence des colons
Cour Pénale Internationale
Criminalisation
Impunité
Climat/environnement
Apartheid
30 mai 2024
Rafah, blocus étudiants et écocide
Analyses politiques et géopolitiques
Colonisation
Eau
Bande de Gaza
Politique française
Jérusalem
Autorité palestinienne
Positions officielles de la France
Nations unies
Torture et mauvais traitements
Universités
Agriculture
Etat de Palestine
Droit international
Solidarité internationale
Enfance/jeunesse
Histoire/analyse politique
Culture / art
Réfugiés palestiniens
Destructions
Aide internationale
La question palestinienne en France
Occupation/annexion
Diplomatie
Hamas
Société civile
Transferts forcés
Crime de guerre
UE/Palestine
Société française
Liberté d’expression
Armement
Violence des colons
Cour Pénale Internationale
Criminalisation
Impunité
Climat/environnement
Apartheid
> Toutes les publications